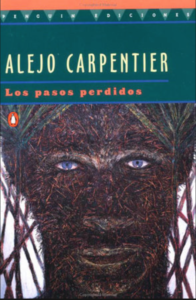
 Alejo Carpentier
Alejo Carpentier
Pour Édouard Glissant, « Le plus grand livre des Amériques, c’est Los pasos perdidos (Le partage des eaux), beaucoup plus grand que Cent ans de solitude [de Gabriel García Marquez] parce qu’il va au fond du baroque de la réalité des Amériques. La re-naturalisation du baroque s’opère là[1]. ». C’est peut-être l’appréciation de ce roman par Édouard Glissant qui l’invita à faire librement usage à plusieurs reprises[2] de son titre « Le partage des eaux ».
À plusieurs reprises, Édouard Glissant cite son « grand ami[3] » Alejo Carpentier dans son oeuvre à propos d’une « caribéanité » partagée. Édouard Glissant présente[4] ainsi l’auteur cubain : « Né à la Havane, de père européen et de mère cubaine, Carpentier vit sa jeunesse d’homme à Paris, après quoi il revient aux Antilles et à l’Amérique latine de son enfance. Dès lors il avance, non point de découverte en découverte, mais de repère en repère. Il retrouve en lui ce que le paysage lui propose. Il tend, non pas vers une accommodation mais en profondeur vers une synthèse. Les problèmes qu’il débat n’intéressent pas une intégration, possible ou non, à un monde étrange [les Antilles], mais bien la conciliation nécessaire entre deux « ordres » qu’il sécrète. Si cette conciliation passe par des jugements, si Carpentier examine par exemple la culture occidentale avec sévérité, n’y voyez pas parti pris, mais impérieuse nécessité pour lui de confronter ses diverses valeurs dans leur plus grande nudité. Voici l’Occident dépouillé des tabous dont il s’est paré afin de perpétuer sa domination ; voici un monde nouveau [les Amériques], avec ses outrances, ses aspirations, ses valeurs. […] Ce débat est d’un choc de cultures, et ce qui est joué ici c’est l’avenue possible d’une unité, d’un style de vie. »
Commentant Le partage des eaux, il écrit : « Faut-il vivre, faut-il exprimer ? Vivre, posséder sa vérité [pour Carpentier, son Amérique « originelle » dans laquelle il se retrouve]. Exprimer, connaître enfin qu’on appartient à son temps [celui de la modernité imposée par « la machine de l’Occident »]. Non point l’un sans l’autre : c’est la leçon du Partage des eaux. Ces deux impératifs correspondraient-ils aux deux ensembles culturels qui s’opposent (pour se rejoindre) dans l’œuvre de Carpentier ? […] Telle est la difficile synthèse. ». « Nous mesurons les difficultés de l’entreprise : qu’il y a une opposition entre l’existence de l’Indienne Rosario et celle du héros du Partage [des eaux] […] entre les architectures modernes de la ville tropicale et les poussées de la Nature qui vient écarteler de ses racines les murs les plus épais, entre le merveilleux, la magie, l’intemporalité de cette Amérique en douloureuse gestation, et les exigences des temps modernes. Mais c’est dans la connaissance de ces inconciliables que sont rendus possibles la synthèse, l’avenir […] ». Plus loin, Glissant précise : « C’est-à-dire que la synthèse est d’abord vocation de synthèse. Ne reculons pas, Antillais, à connaître et à revendiquer les vertus et les traditions tant nègres qu’indiennes qu’européennes venues jusqu’à nous ; mais n’hésitons pas à les rajuster (nous soulignons). Que cette chaude redécouverte de soi n’incline pas à une imploration stérile et exclusive du passé. Cette vocation est projetante : le choc des cultures est une passion dynamique des cultures (nous soulignons). ». N’est-il pas possible de lire dans ces quelques lignes d’approche de l’œuvre de Carpentier les prémisses de la créolisation[5], au sens où Glissant l’entend et la propose ? Ici, un court extrait du roman Le partage des eaux, si cher au poète martiniquais, en manière de mise en relation entre les œuvres des deux auteurs : « Mais dans l’humidité de ce monde [le protagoniste remonte un fleuve d’Amérique latine, comme on remonterait le temps], les ruines l’étaient davantage, les plantes grimpantes disloquaient les pierres d’une façon différente, les insectes avaient d’autres ruses et les diables étaient plus diables quand sous leurs cornes gémissaient des danseurs noirs. Un ange et une calebasse n’étaient pas chose nouvelle en soi. Mais je n’avais vu nulle part ailleurs un ange agitant des maracas, sculpté sur le tympan d’une église incendiée. Je me demandais si le rôle de ces pays dans l’histoire des hommes ne serait pas de rendre possibles, pour la première fois, certaines symbioses de cultures (nous soulignons), quand je fus distrait de mes réflexions par quelque chose qui faisait naître en moi un écho à la fois très proche et très lointain[6]. ».
Avec Alejo Carpentier, Édouard Glissant estime partager des problématiques communes à ce qu’il nomme « le Roman des Amériques[7] ».
En premier lieu, une « obsession essentielle » qui est « la crispation du temps ». « Ce qui « se passe » en fait, c’est qu’il semble qu’il s’agisse de débrouiller une chronologie qui s’est embuée, quand elle n’a pas été oblitérée pour toutes sortes de raisons, en particulier coloniales. Le romancier américain, quelle que soit la zone culturelle à laquelle il appartient, n’est pas du tout à la recherche d’un temps perdu, mais se trouve, se débat, dans un temps éperdu. Et, de Faulkner à Carpentier, on est en présence de sortes de fragments de durée qui sont engloutis dans des amoncellements ou des vertiges. On a vu que la poétique du continent américain, que je caractérise comme étant d’une quête de la durée, s’oppose en particulier aux poétiques européennes que se caractériseraient par l’inspiration et l’éclatement de l’instant. […] Ce temps éclaté, souffert, est lié à des espaces « transportés ». […] Confronter le temps, c’est donc ici en nier la linéarité. Toute chronologie est trop immédiatement évidente, et dans l’œuvre du romancier américain, il faut se battre contre le temps pour la reconstitution d’un passé, même en ce qui concerne les régions d’Amérique où la mémoire historique n’a pas été oblitérée. Il s’ensuit que, pris aux vertiges du temps, le romancier américain le dramatise pour mieux le nier ou le « refaire » : je dirai sur ce point que nous sommes les casseurs de pierre du temps. Nous ne le voyons pas s’étirer dans notre passé (nous porter tranquilles vers l’avenir) mais faire irruption en nous par blocs, charroyés dans des zones d’absence, où nous devons difficilement, douloureusement, tout recomposer si nous voulons nous rejoindre et nous exprimer. ». Question du temps antillais que Glissant va pétrir dans son œuvre au moins à partir de son roman Le quatrième siècle :
« La deuxième donnée de la poésie, pour moi, après cette espèce de poétique de l’espace, cette poétique du paysage, ça a été une poétique du temps qui a été surtout exprimée dans mon deuxième roman : Le quatrième siècle. Parce qu’il était évident, pour nous, et quand je dis « nous », je ne dis pas seulement les Martiniquais, les Guadeloupéens, je dis aussi tous les Caribéens et tous les Américains, il était évident que, dans les Amériques, il y avait les peuples qui avaient réussi à garder leurs mémoires vivantes et il y avait les peuples dont on avait tenté de raturer la mémoire historique. Et la Martinique et la Guadeloupe et les petites Antilles faisaient partie de ces peuples-là. Je me souviens que quand j’étais enfant, on avait un livre d’Histoire de la Martinique : c’était purement et simplement la liste des Gouverneurs de la Martinique. La population, les conditions de vie, les révoltes, les fusillades, les massacres : rien ! Ce qui fait que le temps, pour nous, et en particulier le temps historique, était raturé et qu’il fallait le recomposer. Et nous ne pouvions pas le recomposer d’une manière fluide comme Proust qui, quand il écrit À la recherche du temps perdu, peut bâtir une cathédrale de mémoire(s). J’ai écrit à cette époque que notre temps n’était pas un temps perdu, puisque nous ne l’avions jamais possédé, mais un temps éperdu. Et je disais qu’une poétique qui pourrait remonter ce temps-là serait comme un homme ou une femme qui sauterait de roche en roche sur une rivière pour la traverser[8]. »
Question qui traverse également Le discours antillais : « Du point de vue du temps : Ne pas se dater. L’absence de mémoire collective réduit la dimension temporelle à une succession de donnés naturels qui ne se dépassent pas. Peut-on nier le temps ? Peut-on ramener le temps à un calendrier de faits naturels ? Le principe ici soutenu est que la réponse collective à une telle problématique exige que la communauté concilie nature et culture dans une pratique collective libérée – ce qui n’est pas encore notre cas[9]. » D’où le travail du poète sur le temps antillais, fracturé, fragmenté, non linéaire, en quête d’une « durée » (à l’échelle collective) pour lutter contre « le discontinu » historique à travers ses essais et son cycle romanesque.
Par ailleurs, la relation entre l’auteur martiniquais et l’auteur cubain est également nourrie par la quête d’un langage propre aux réalités caribéennes. Dans Introduction à une Poétique du Divers, Glissant rapporte des propos de Carpentier :
« Alejo Carpentier me disait dans une conversation quelque temps avant sa mort : « Nous autres Caraïbéens nous écrivons en quatre ou cinq langues différentes mais nous avons le même langage. ». L’art du conteur créole est fait de dérives en même temps que d’accumulations, avec ce côté baroque de la phrase et de la période, ces distorsions du discours où ce qui est inséré fonctionne comme une respiration naturelle, cette circularité du récit et cet inlassable répétition du motif. Tout cela converge en un langage qui court à travers les langues de la Caraïbe, anglaise, créole, espagnole ou française, qu’elle soit de Carpentier, de Walcott ou des écrivains francophones de la Martinique, de la Guadeloupe ou de Haïti. Et le merveilleux, voyez-vous, c’est que cette exploration d’un langage par et par-delà les diverses langues utilisées ne pervertit en rien aucune d’elles et ajoute à chacune, les convoquant toutes en un point focal, un lieu de mystère ou de magie où, se rencontrant, elles se « comprennent » enfin[10]. ». Quête d’un langage caribéen qui entre en résonance avec la créolisation de la langue au sens où Glissant l’entend et la défend : « Le conteur créole se sert de procédés qui ne sont pas dans le génie de la langue française, qui vont même à l’opposé : les procédés de répétition, de redoublement, de ressassement, de mise en haleine. Les pratiques de listage que Saint-John Perse a utilisées dans sa poétique et que j’esquisse dans beaucoup de mes textes, ces listes interminables qui essaient d’épuiser le réel non pas dans une formule mais dans une accumulation, l’accumulation précisément comme procédé rhétorique, tout cela me paraît être beaucoup plus important du point de vue de la définition d’un langage nouveau, mais beaucoup moins visible[11]. »
Enfin, dernier lien (indirect) entre Glissant et Carpentier : le roman Le Siècle des Lumières de l’auteur cubain conte (en partie) la première abolition de l’esclavage en Guadeloupe (donc aux Antilles françaises) en 1794 par les troupes de Victor Hugues qui, pour ce faire, bataillèrent contre les troupes anglaises dont l’arrivée sur l’île avait été facilitée par les planteurs esclavagistes soucieux de garder le système de Plantations en place. Il est dit qu’Alejo Carpentier écrivit (du moins en partie) son roman en Guadeloupe, plus précisément dans la ville du Gosier, face à la mer Caraïbe « qui diffracte et qui porte à l’émoi de la diversité[12] ».
[1] Discussion à la suite de la communication de Benito PELEGRIN « Insularité/singularité des écritures : archipel baroque (de Gracián à Lezama Lima) » dans le cadre du séminaire de l’Institut du Tout-Monde, Décembre 2008. Voir l’intégralité de cette communication ici :
[2] Notamment dans La cohée du Lamentin pour évoquer l’annonce par les médias de la disparition à venir de l’île de la Martinique dans un immense séisme apocalyptique (La cohée du Lamentin, Paris, Gallimard, 2005, pp.13-14).
[3] Interview d’Édouard GLISSANT dans le cadre du tournage du documentaire Kreol, 79 min., Frédérique Menant, Zaradoc, 2010. Voir la Bande-Annonce de ce documentaire ici :
[4] L’Intention Poétique (1969), Paris, Gallimard, 1997, pp.130-136.
[5] « Depuis ces Archipels que j’habite, levés parmi tant d’autres, je vous propose que nous pensions cette créolisation. Processus inarrêtable (nous soulignons), qui mêle la matière du monde, qui conjoint et change les cultures des humanités d’aujourd’hui. Ce que la Relation nous donne à imaginer, la créolisation nous l’a donné à vivre. […] Son fait, par-delà ses conditions le plus souvent désastreuses, est d’entretenir relation entre deux ou plusieurs « zones » culturelles, convoquées en un lieu de rencontre, tout comme une langue créole joue à partir de « zones » linguistiques différenciées, pour en tirer sa matière inédite. » (Paris, Gallimard, 1997, p.25)
[6] Le partage des eaux (1953), Paris, Gallimard, « Folio », 1976, p.161.
[7] Le discours antillais (1981), Paris, Gallimard, « Folio Essais », 1997, pp. 435-437.
[8] Intervention orale de Glissant à Nantes à l’occasion de la commémoration du 10 Mai 2009. Voir la vidéo intégrale ici :
[9]Le discours antillais, op. cit., p. 492.
[10] Introduction à une Poétique du Divers, Paris, Gallimard, 1996, p.43.
[11] L’imaginaire des langues, Paris, Gallimard, 2010, p.26.
[12]Introduction à une Poétique du Divers, op.cit., pp. 14-15.
